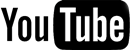Souvenirs de Rome
Destination de pèlerinages religieux depuis le Moyen-Âge et du voyage de formation pour les artistes dès l’époque humaniste, Rome deviendra le moment culminant du Grand Tour à partir du milieu du XVIIe siècle et accueillera des colonies d’artistes étrangers. L’évolution de la représentation de la ville à travers les siècles est donc marquée par ces présences et par le marché bigarré qu’elles ont alimenté. La peinture du paysage, influencée au XVIIe siècle par la leçon des Carrache et de Domenichino, de Nicolas Poussin et de Claude Lorrain, développe encore une fois à travers la production d’artistes du nord comme Jan Franz Van Bloemen, dit l’«Horizon», un nouveau sentiment de la nature, avec la réévocation d’un monde incontaminé, peuplé de figures mythologiques et historiques, entre ruines classiques ou constructions de fantaisie.
La campagne romaine, avec son territoire riche en forêts, roches tufacées et cours d’eau, de collines et de vallées, fournit un archétype adapté à ce genre pictural dont le succès traverse le XVIIIe siècle tout entier. Ainsi naissent les paysages idylliques d’Andrea Locatelli et Paolo Anesi et les caprices de Giovan Paolo Panini et des artistes liés à l’Académie de France.
D’autre part, l’exigence d’une nouvelle fidélité au vrai introduite par Gaspar Van Wittel au début du siècle, aura sa maturation dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans les œuvres de paysagistes suisses, anglais, français et allemands comme Louis Ducros, Jacob More, Jacob Philipp Hackert. Si la recherche du vrai est encore contaminée, à la fin du XVIIIe siècle, des formules du paysage classique du XVIIe, dont le naturalisme est filtré et réglé par une organisation harmonique des espaces, au XIXe siècle l'image réelle de la ville et de ses alentours émerge définitivement grâce à l'apport, prioritaire encore, Franz Knebel, John Newbott, Edward Lear, Arthur John Strutt et John Ruskin, et par la suite grâce à l’exemple extraordinaire que laissera Ippolito Caffi lors de son séjour romain.
La vue gravée entendue comme reproduction de lieux déterminés de la ville de Rome topographique, documentaire et exacte jusque dans la description des détails, s'affirma au cours du XVIIe siècle et fut redevable de sa fortune à la consolidation de la nouvelle image que les réalisations architecturales de l’époque baroque donnèrent à la ville: c’est la raison pour laquelle, au cours du XVIIe siècle, le marché de la gravure ne s’adresse plus seulement à la reproduction de restes classiques, mais se concentre surtout sur la ville moderne, ce également grâce au labeur de graveurs habiles qui avec leurs œuvres, toujours très demandées, décrétèrent le succès du genre pendant des siècles. Le premier de ces artistes fut, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, Giovan Battista Falda, auteur du «Nouveau Théâtre des fabriques et bâtiments en perspective de la Rome moderne», œuvre en trois livres consacrée à la diffusion de la nouvelle image de la ville et à ses scénographiques architecturales. Le genre de la vue gravée est bien représenté à travers les œuvres de ses principaux interprètes comme le propre Falda et Alessandro Specchi, architecte et graveur continuateur de son œuvre, ou comme Giuseppe Vasi qui constitua, au milieu du XVIIIe siècle, un corpus d'images dédiées à la captation analytique de tous les aspects de la ville, des ponts sur le Tibre aux places en passant par les églises, divisé en dix livres sous le titre «Les Magnificences de Roma antique et moderne». En effet, le panorama des vues gravées s'élargit au XVIIIe siècle pour englober aussi bien la ville ancienne que la moderne; la coupe perspective des prises de vue se fait moins rigide, et l’effet final est plus varié, se jouant désormais davantage sur la recherche du pittoresque des clairs-obscurs que sur le linéarisme et l’essentialité.
Successivement, à partir des années Soixante du XIXe siècle, la prise de vue photographique de vues et de monuments est devenue l’héritière directe de la gravure et de la peinture et modèle sur ces précédents son propre langage.